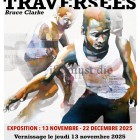« C'est une oeuvre d'art, Guernica, qui nous rappelle aujourd'hui, et plus de soixante ans après qu'elle a eu lieu, la tragédie du petit village basque, non pas les journaux du temps ni l'histoire savante des manuels. L'oeuvre d'art, aujourd'hui comme autrefois, peut porter témoignage d'une façon aveuglante et définitive, là où les autres moyens ne sont que de pauvre et fugace, ou difficile, information ».
(Jean Clair, La responsabilité de l'artiste, p.19)
La nécessité de figurer
On peut penser que depuis ses origines la peinture à partie liée avec la mort et qu'elle s'est évertuée de domestiquer les forces du mal et de témoigner d'une possible reconstruction. C'est peut-être ainsi que Bruce Clarke a senti la nécessité de s'engager dans ses projets picturaux. Si l'engagement politique peut être différent de ce qui se passe dans la création plastique, il peut néanmoins en permettre le surgissement, comme si le besoin de « figurer », de donner figure à ce qui ne peut se laisser voir, était soudain urgent et primordial. La scène primitive serait-elle alors la scène figurative ? Le besoin de "re-présenter" prendrait ainsi le dessus pour apaiser la violence des images insupportables ou refoulées au fond de la mémoire.
« Mon travail plastique sur le Rwanda est issu d'un travail politique bien antérieur au génocide. La situation était en fait bien prévisible quand on connaissait le contexte politique du pays et les soutiens dont le régime génocidaire bénéficiait en France. C'est donc plus tard qu'avec des amis et des militants on s'est posé la question : « Comment réagir ? Comment dire quelque chose de valable à propos de ce qui s'est passé là ? Toi, tu es artiste, me disaient-ils, travaille dans ton domaine. Et la question était alors de savoir si l'art pouvait avoir un rôle à jouer dans cette reconstruction. »
(B.Clarke, Entretien, Août 2002).
Il est évidemment impossible de rendre compte des multiples témoignages en histoire de l'art qui se réfèrent à cette problématique de l'art et la mémoire. On va se contenter d'évoquer quelques artistes et leurs oeuvres les plus représentatives.
Le trois mai 1808 de Francisco Goya, 1814
Ce tableau fait aujourd'hui figure d'emblème des « malheurs des guerres » au même titre que Guernica de Pablo Picasso. Les deux peintres espagnols ont ainsi rempli les volets d'un diptyque qui place leur art au sommet du tragique universel.
La guerre d'indépendance espagnole (les troupes de Napoléon sont entrées en Espagne en 1807) incite Goya six ans plus tard à réaliser sur une seule toile une sorte de synthèse de toutes les expériences vécues au cours des années de conflit. « Qui peut oublier le regard halluciné de l'homme à la chemise blanche ? » Devant un monticule terreux, et suivant une diagonale lumineuse sur le sol nu, Goya met en scène un affrontement entre les troupes de soldats français, réduits à des silhouettes sans visage et des paysans espagnols. Les lignes des baïonnettes, dans le prolongement de celles des jambes, font de ce peloton une machine à tuer. Face à eux, le personnage principal, en pleine lumière, écarte les bras, halluciné. À ses pieds, des mourants et des cadavres gisant dans le sang. Ainsi épurée, la fusillade conçue par Goya est bien plus qu'une scène historique de l'insurrection madrilène, car elle parle le langage universel de l'oppression aveugle. Ce tableau a inspiré Manet dans l'Exécution de Maximilien (1867) et plus tard Picasso dans le Massacre de Corée (1951).
Guernica de Pablo Picasso, 1937
« Je crois que lorsque de grands artistes ont fait changer quelque chose dans la peinture, leur moteur n'était pas la peinture ; ils avaient des choses si nouvelles à dire, de telles nécessités, qu'ils ont nécessairement trouvé des formes nouvelles pour les dire » (Ernest Pignon-Ernest, L'homme habite poétiquement, p. 49).
Encore une guerre d'Espagne, celle de 1936 (au cours de laquelle Robert Cappa a immortalisé la fusillade d'un républicain, sorte de "version photographique" du Trois Mai de Goya). La grande nouveauté de Guernica, autre icône de la tragédie destructrice des guerres, est liée à l'appropriation des médias de l'époque (journaux, photos, films d'actualités) qui constituent la véritable clé iconographique de l'oeuvre. Au printemps 1937, le pays basque entier tombe aux mains des franquistes et leurs alliés allemands et italiens. Durango est anéanti, puis Guernica, Bilbao, Santander. Mais c'est Guernica qui est resté la plus vive dans nos mémoires.
La source réelle du tableau, le déclic d'où il est issu, c'est l'actualité, mais l'actualité à distance, médiatisée par les journaux du soir. En effet, Picasso se trouve à Paris, Il est célèbre et riche, néanmoins, cette guerre l'ébranle profondément.
Le 26 avril 1937, les cloches se mettent à sonner à l'église de Guernica, les avions lâchent leurs bombes et tuent plus de 1600 personnes. Quatre jours plus tard, Picasso qui « tourne en rond dans son atelier des Grands Augustins » voit les photos et les gros titres qui figurent à la une de Ce soir et se met à dessiner et tracer les premières esquisses de ce qui deviendra le cri d'effroi des guerres modernes. Le 10 mai, il exécute sur la toile même les premiers tracés de l'oeuvre (on comptera sept versions successives photographiées par Dora Maar) et le 3 juin, le tableau est terminé. Le 4, il prend place au pavillon espagnol de l'Exposition universelle à Paris, auquel il était destiné, accompagné d'un poème d'Eluard. Le tableau est noir, blanc, gris, comme les journaux qui ont relaté l'événement à l'homme de la rue qui découvre le désastre. La nouveauté plastique inventée par Picasso a consisté à travailler le tableau par le biais d'images et de textes imprimés, médiatisés. Ce faisant, cette nouveauté plastique est directement issue d'une nécessité à dire autrement.
Guernica est noir, blanc et gris comme les films d'actualités, les photos de presse qui sont, à plus d'un titre, partie intégrante de l'oeuvre.
Dessins de Zoran Music à Dachau, 1945
Zoran Music, peintre slovène, né en 1909, est déporté en 1944 à Dachau pour avoir refusé de s'enrôler dans les SS. À la libération des camps, il s'établit à Venise où il peint et commence à se libérer des visions qu'il a conservées de son séjour concentrationnaire. Son témoignage est puissant et « saisi sur le vif ».
Proche de Schiele, Kokoschka mais aussi de Goya, Zoran Music est l'héritier des peintres du corps douloureux et souffrant. Et c'est armé d'un crayon qu'il a pu assumer sa qualité de témoin. Il s'est servi de supports et outils précaires, tout ce qu'il trouvait : papiers d'emballage, feuillets arrachés aux registres, un peu d'encre, bouts de crayons volés. De fait, la volonté de dessiner et de témoigner l'a maintenu en résistance.
« Je ne voulais pas illustrer, faire des documents. Je dessinais ce qui pouvait intéresser un peintre. Je ne me considérais pas comme un reporter. Il y a des choses visuelles et il y a des choses que l'on sent et que l'on peut faire même les yeux fermés. On s'exprime soi-même. Oui, c'est comme un paysage intérieur. »
(Jean Clair, La barbarie ordinaire, Entretien avec Zoran Music, p. 137 et 146).
La Commune et autres oeuvres in situ de Ernest Pignon-Ernest, 1966
À première vue, il semble y avoir de nombreux points communs entre le travail et Bruce Clarke et celui d'E.P-E. pour qui la forme la plus accomplie de l'engagement est celle qui nous situe dans notre temps, mais surtout en dehors des galeries ainsi que des ateliers, et plus exactement sur les murs de la ville.
« C'était une intervention sur la Commune, l'interaction entre l'image, les lieux et le moment . Pour la guerre du Viet-Nâm, je me remettais à peindre ces corps expressionnistes, tendus, déchirés, mais il m'apparaissait de plus en plus indispensable d'y intégrer tout ce qui nous servait d'information - presse, télé, media - de prendre en compte plastiquement ces données plus objectives. »
En ce sens il a développé le principe de Picasso dans Guernica qu'il explicite en ces termes :
« Il s'agit de se saisir du réel comme d'une palette : le temps, centième anniversaire de la semaine sanglante, les lieux : Charonne, le Sacré-Coeur, pour leur potentiel poétique, dramatique. C'est en collant la nuit, sur les marches du métro, avec l'émotion, le souvenir réactivé par la nuit, le côté clandestin du collage, que j'ai ressenti que si mon travail restait un travail plastique, j'organisais mes images, j'utilisais les ruptures des marches, l'enfoncement du volume de l'escalier. Mais je prenais surtout en compte la charge symbolique que portait ce lieu dont mes images se chargeaient tout en la réactivant»
Marcelin Pleynet, Ernest Pignon-Ernest, Habiter poétiquement, p. 31-35)
Ainsi donc, la question de l'inscription dans un lieu, de la mise en situation de l'oeuvre lui semble essentielle ; ce n'est pas le cas de Bruce Clarke. Écoutons encore Ernest P-E. :
« Je sais que je ne règle pas tout le thème que je souhaite saisir, uniquement avec le dessin, une grande partie du sens viendra du lieu où il sera inscrit. Des qualités propres, plastiques et symboliques de ce lieu et des virtualités suggestives que cette insertion devrait y provoquer. Il ne faut pas que le dessin apparaisse comme un dessin exposé dans la rue mais qu'il noue des liens physiques avec le mur, le sol, l'espace de la rue, il faut que certains de ses éléments deviennent partie du dessin. »
(Marcelin Pleynet, E.P-E., Habiter poétiquement, p. 33, 76).
Texte : Michèle Baj-Strobel